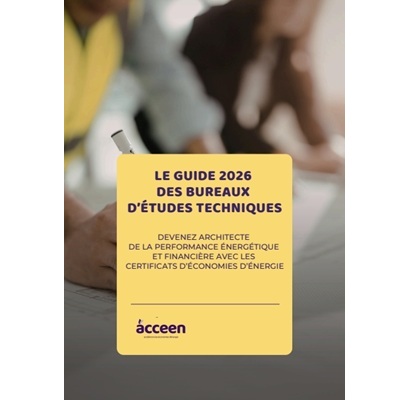Chauffage : pourquoi l'essor des réseaux de chaleur devrait être davantage considéré

Et si la décarbonation des territoires passait par les réseaux de chaleur renouvelable ? Suite à une étude réalisée par le cabinet Carbone 4 et consacrée à l'état de la filière et ses perspectives de développement, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) insiste sur l'intérêt économique, énergétique et environnemental de ces infrastructures, dont le déploiement accuse cependant un certain retard.
D'après l'Ademe (Agence de la transition écologique), le chauffage représente 66% de la consommation d'énergie totale d'un ménage, et la France s'avère particulièrement dépendante des importations de combustibles fossiles dans ce domaine.
Les réseaux de chaleur renouvelable sont alors présentés comme une "alternative durable", dans la mesure où ils se basent sur un taux moyen d'énergies renouvelables et de récupération de 66,5% (dominé par la chaleur fatale issue des UVE - unités de valorisation énergétique -, à 29%, suivie par la biomasse à 25,5%, et la géothermie à 5,5%), cette fois selon la Fedene (Fédération des services en énergie et environnement).
Doublement des installations... et des investissements
Mais si des acteurs publics comme privés se mobilisent pour pousser ces solutions, leur montée en puissance reste faible : à l'heure actuelle, les réseaux de chaleur renouvelable alimentent environ 50.000 bâtiments en France, ce qui représente une couverture de 5,3% des besoins de chauffage du pays, alors que la moyenne européenne est de 13%.
L'État semble avoir pris conscience de ce retard et cherche, via la 3e version de la PPE (Programmation pluriannuelle de l'énergie), à le combler : d'ici à 2035, le texte ambitionne d'atteindre 90 térawatts-heures de chaleur livrée par ces réseaux, soit un triplement de la production actuelle. D'après l'étude de Carbone 4, cela impliquerait l'installation de 595 km de nouveaux réseaux de chaleur chaque année, contre 350 km en rythme annuel aujourd'hui.
Des objectifs "ambitieux" qui vont nécessiter un doublement des investissements annuels : de 646 millions d'euros en 2022, ceux-ci devraient grimper à plus de 1,2 milliard d'euros en 2035, pour une enveloppe cumulée de 8,9 milliards d'euros sur la période 2025-2035. Sur le même laps de temps, les coûts cumulés de maintenance s'élèveraient quant à eux à 5,9 milliards d'euros.
Simplifier les procédures d'urbanisme
Pour y subvenir, le Fonds chaleur, géré par l'Ademe, est présenté comme "le principal levier de financement pour le développement des réseaux de chaleur et la production de chaleur renouvelable et de récupération". Le dispositif, créé en 2009, aurait jusqu'à présent soutenu "8.500 installations d'ENR&R, représentant 3.800 km de réseaux et ajoutant 45,4 TWh par an d'ENR&R à l'approvisionnement énergétique français".
En versant 4,28 milliards d'euros d'aides publiques, le Fonds chaleur aurait ainsi généré environ 14 milliards d'euros d'investissements. Doté d'un budget de 800 millions d'euros pour l'exercice 2025, il resterait toutefois "largement insuffisant pour répondre aux objectifs de la PPE3". Fedene en tête, plusieurs acteurs du secteur ont donc réclamé un "Plan Marshall pour la chaleur renouvelable et de récupération", qui consisterait à augmenter progressivement la dotation du Fonds chaleur jusqu'à atteindre 3 milliards d'euros en 2030.
Quoi qu'il en soit, ce dernier n'est pas le seul dispositif de soutien aux réseaux de chaleur. Les CEE (certificats d'économie d'énergie), la TVA réduite à 5,5% pour les réseaux alimentés à plus de 50% en ENR&R, des aides locales et des fonds régionaux, ainsi que les prêts à taux bonifiés de la Banque des territoires et de la Banque européenne d'investissement peuvent aussi être mobilisés.
Enfin, l'étude pointe du doigt les obstacles réglementaires et administratifs. Selon ses auteurs, "l'extension des réseaux est freinée par des procédures longues et complexes, ainsi qu'une répartition territoriale inégalée". Pour y remédier, ils préconisent de renforcer les incitations "à la densification urbaine" et de simplifier les démarches de raccordement, deux pré-requis jugés "déterminants pour accélérer la transition vers un chauffage plus durable".