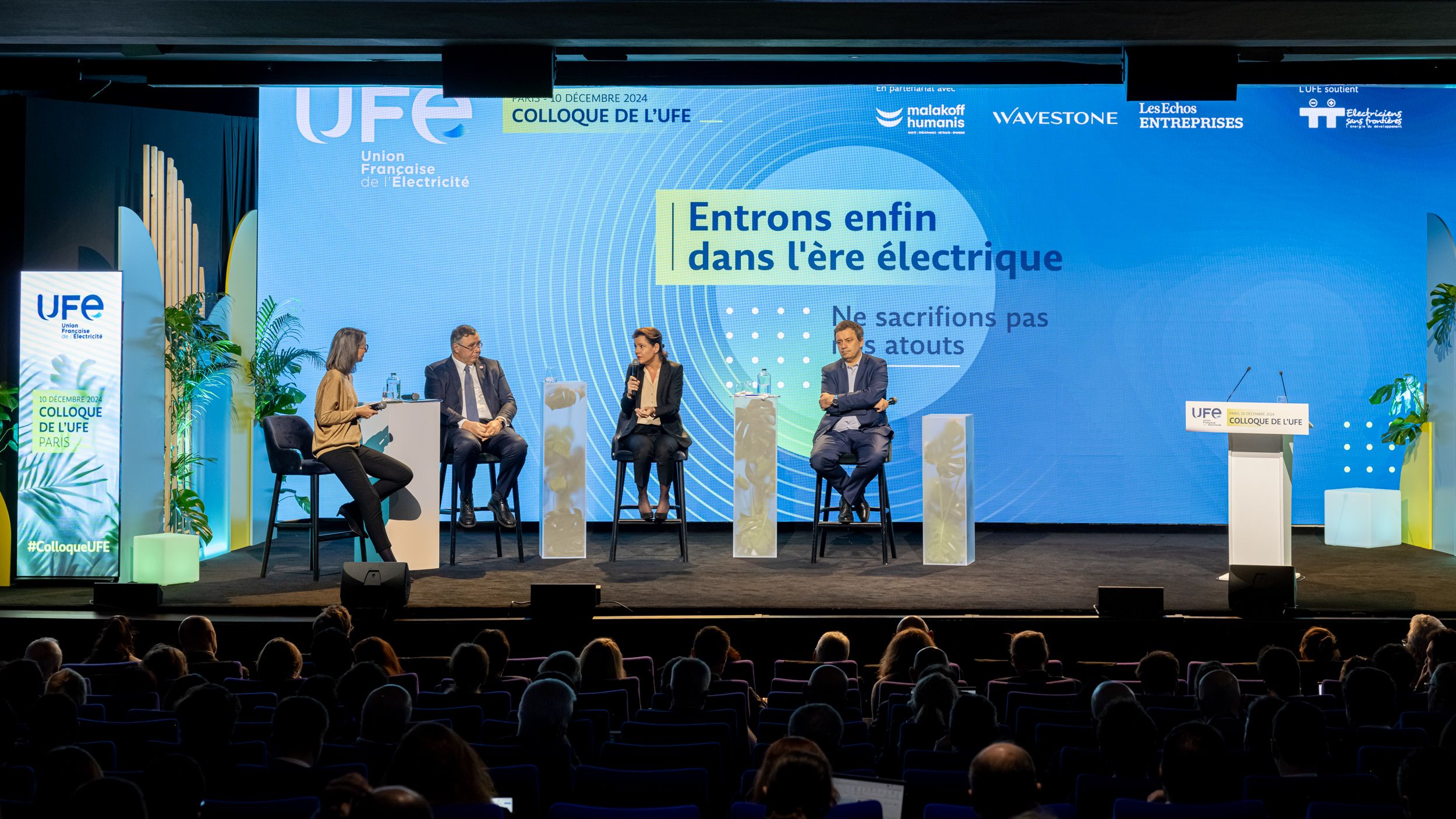Le passif en paille s’affirme dans toutes les constructions

"Être actif dans le passif !" Fin février 2025, l’association La Maison Passive a organisé un webinaire démonstratif des capacités de la construction paille à répondre aux principes du label allemand Passiv Haus.
Les deux intervenants retenus, l’ingénieur thermicien Pierre Janin, du bureau d’études Héliasol (Val d’Epy, Jura), et l’architecte Julien Rivat, basé à Saint-Étienne, ont présenté une dizaine de réalisations et le retour d’expérience qu’ils en ont tiré.
Depuis la publication, début des années 2010, des règles professionnelles de la construction paille par le Réseau français de la construction paille (RFCP), certaines techniques développées entrent parmi les techniques courantes. L’application de règles d’assurance spécifiques depuis 2014 ont aussi permis de propulser des projets.
Pour les militants de cette technique de construction, la paille recèle une foule d’avantages. En premier lieu, le gisement est abondant – elle sert de moins en moins à la litière, n’est pas consommée par les animaux de ferme –, renouvelable et même recyclable. Pas seulement par compostage, mais elle peut être reprise à la déconstruction, remise en botte et réutilisée comme isolant.
Placée dans les murs, elle ne serait pas attaquée par les rongeurs. Elle ne nécessite pas d’adjuvant – comme la laine de bois qui contient du polyester. Enfin, elle supporte les tests d’incendie pendant trois heures ; des exercices menés en Tchéquie l’ont montré.
Surtout, des développements apparaissent. Les pailles de lavande ou de riz sont citées comme alternatives ou gisements à ajouter à la paille de blé. Par ailleurs, l’initiative prise par l’entreprise poitevine Ielo, créatrice de la paille hachée à insuffler, fait parler d’elle. L’appréciation technique expérimentale qu’elle a décroché pourrait assez rapidement être convertie en avis technique.
En outre, la technique de traitement de la paille initiée sur le site de Bonneuil-Matours, entre Poitiers et Châtellerault, pourrait prochainement être proposée à d’autres intervenants, industriels ou coopératives céréalières. Ce qui permettrait de déployer le produit sur tout le territoire.
Les logements restent le débouché le plus important pour cette technique de construction innovante… malgré son ancienneté millénaire. À Vaulx-en-Velin, la coopérative d’habitants Chamarel a développé le bâtiment collectif "Les Barges", seize logements en structure béton avec isolation paille et enduit intérieur en terre crue de 4 cm.
L’architecte a dû batailler avec le contrôleur technique qui imposait des plaques de plâtre de 13 ou 18 mm. Le chantier n’est cependant pas ressorti "passif" en raison de l’abandon de la ventilation double flux.
À Saint-Étienne, la métropole a été livrée en 2019 d’un lotissement de 18 maisons individuelles passives conçues par Julien Rivat, pour l’occasion architecte et promoteur. Treize d’entre elles présentaient une structure béton avec isolation par l’extérieur ; cinq étaient réalisées en structure bois avec isolation paille.
Le principal point noir de la paille est l’important besoin de main-d’œuvre, "mais il serait moins cher si on prenait en compte les pollutions et l’épuisement des ressources" liés aux autres matériaux.
Il s’est servi de cette expérience pour comparer les modes constructifs et mesurer le confort d’été. Si les maisons bois-paille ressortent d’un coût supérieur de 13%, il remarque que la qualité d’exécution est meilleure. "Mais plus on fera de paille, plus l’écart se réduira." Par ailleurs, certaines opérations s’avèrent plus rapides, comme la pose des menuiseries extérieures. Quant au confort d’été, il est mieux géré dans les maisons bois-paille en raison de leur plus faible inertie thermique.
La paille est aussi exploitable en rénovation pour atteindre un niveau passif. L’opération a été menée par les architectes Stéphane Peignier et Hélène Palisson sur un pavillon des années 80 en blocs béton et isolation PSE. Seul le périmètre de béton a été conservé. L’isolation par l’extérieur a été réalisée en paille.
Les fondations initiales ont été renforcées d’une longrine béton pour supporter le poids de la paille. À l’intérieur, les enduits de terre crue assurent l’étanchéité à l’air, d’un niveau final de 0,53. La rénovation s’est soldée par un coût moyen de 1.100 €/m².
Les collectivités locales sont moins frileuses à oser la construction bois associé à l’isolation paille. À Saint-Étienne, l’école Saint-Michel a complété son patrimoine avec local en R+1 comprenant un gymnase, trois salles de classe, des locaux administratifs et des sanitaires. Construits sur un soubassement en béton, les murs sont composés d’une juxtaposition de caissons chargés de bottes de paille. L’ouvrage se distingue par le détail du montage et l’attention apportée à la garde d’eau, notamment en posant une cour anglaise.
Le passif en paille a aussi été adopté par les architectes LA Architecture et l’Atelier Desmichelle pour la réalisation d’une école sur le boulevard Auriol, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Le chantier a été livré en 2019. Les caissons ont été chargés en paille et laine de bois ; les éléments de laine de bois permettent de terminer le calepinage d’isolation en s’affranchissant du délai de recoupe des bottes de paille. Ici comme sur tous les chantiers bois-paille, l’attention a été portée sur la garde à l’eau au rez-de-chaussée.
Les projets les plus audacieux présentés sont ceux de deux centres de dialyse de 800 m² chacun construits à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) et à Gray (Haute-Saône), livré début 2025 et en cours de labellisation Passiv Haus. Les investisseurs ont accepté le défi en raison du respect de l’enveloppe budgétaire de 800.000 € pour chaque projet. La principale difficulté a été de convaincre le bureau de contrôle qu’il était possible de produire des locaux de santé avec équipement de refroidissement et une isolation en paille.
De l’avis des animateurs de ce webinaire, la paille figure parmi les moins chers des isolants. Techniquement, il permet d’atteindre des résistances d’isolation thermique R de 6 à 7. Son principal point noir est l’important besoin de main-d’œuvre, "mais il serait moins cher si on prenait en compte les pollutions et l’épuisement des ressources" liés aux autres matériaux, expliquent les animateurs.
À l’avenir, l’un des secteurs d’usage privilégiés pour la paille serait la préfabrication pour des grands projets de construction. Les coûts de main-d’œuvre pourraient ainsi être absorbés par "la construction en temps masqué en atelier".
Enfin, plusieurs évolutions paraissent en bonne voie d’aboutissement : celui de la paille porteuse dont les règles professionnelles sont en cours de développement, l’isolation en paille des chambres froides et celui de l’isolation thermique par l’extérieur dont les règles prendront encore deux ou trois ans.
Lire aussi
-
Pourquoi le béton de bois prétend avoir sa place dans la décarbonation du bâtiment
-
"Pour se décarboner, le secteur du bâtiment doit remettre au goût du jour des techniques anciennes"
-
"Des performances mécaniques supérieures" : ce qu'il faut savoir sur ce bois "augmenté"
-
Pour ses dix ans, Karibati a "labellisé plus d'une centaine de produits biosourcés"