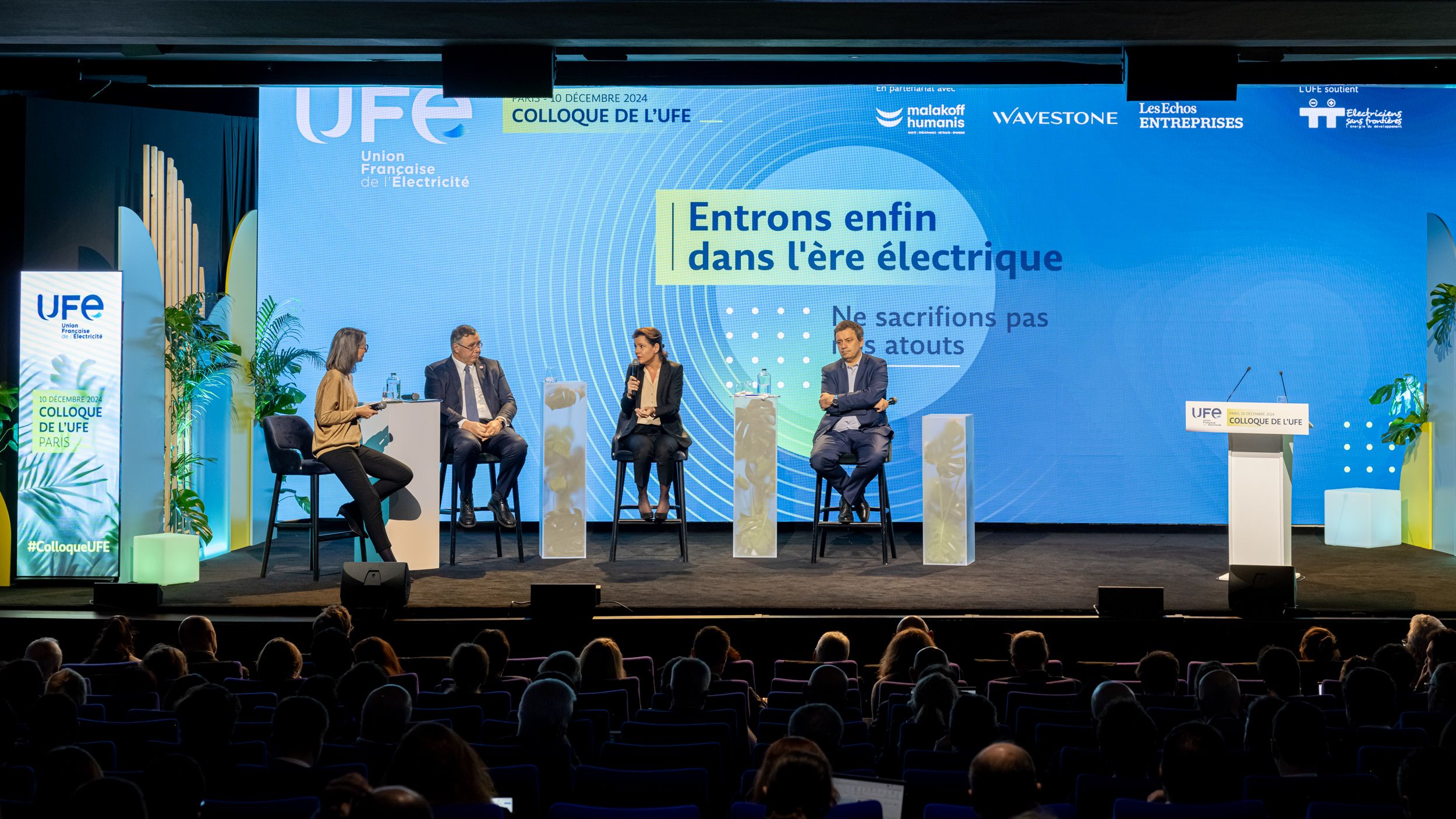L’eau en 2025 : un grand défi à apprécier à une petite échelle

Après la ressource, la demande en eau. Commandé à France Stratégie mi-septembre 2023 par Élisabeth Borne, alors Première ministre, le rapport "La demande en eau – Prospective territorialisée à l’horizon 2050" est paru le 20 janvier. Il a été piloté par Hélène Arambourou, adjointe au directeur du département "Développement durable et numérique" du service de prospective rattaché à Matignon, également ingénieure des Ponts, des eaux et des forêts, et Simon Ferrière, chef de projet au sein du même département, aussi ingénieur et licencié en droit.
Il complète le travail déjà mené de 2021 à 2024 par l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), intitulé Explore2, sur l’impact du changement climatique sur la ressource en eau.
Les épisodes caniculaires de 2022 et 2023 ont éveillé les consciences sur ce problème. Quelque 700 communes ont connu des épisodes sans distribution d’eau au robinet de leurs résidents. Et ce, alors que le volume d’eau dite "utile", actuellement en forte diminution, est de 50 milliards de mètres cubes, que la consommation totale est d’environ 25 Mds de m³, que le prélèvement est de l’ordre de 4 à 5 Mds de m³ et la consommation, d’environ 700 millions de mètres cube. La latitude est en réalité très faible.
Le changement climatique s’accompagne d’une intensification des événements extrêmes et d’une diminution de l’eau renouvelable
L’étude développée en collaboration avec d’autres organismes – Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), Météo France, Inrae… – est présentée comme une première approche et ses auteurs en fixent ses contours : "Cette étude ne vise pas à prévoir la demande en eau future, mais plutôt à imaginer quelle pourrait être cette demande en fonction de choix de société structurants". En clair, elle contient des projections pour les prochaines décennies qui donnent aux pouvoirs publics le profil des difficultés à surmonter. À eux de développer les stratégies.
Compte tenu de l’importance de ce sujet, France Stratégie a organisé, le 21 janvier, une table ronde avec les auteurs et des parties prenantes pour présenter ce rapport et les enjeux autour des sujets que celui-ci met en évidence.
Impossible d’évaluer correctement ces problèmes en abordant le sujet au niveau strictement national. Les événements récents montrent bien que la situation dans le nord de la France diffère radicalement de celle des Pyrénées-Orientales. La "maille" retenue est à la fois géographique et socio-économique.
Les rapporteurs ont exploité toutes les données disponibles auprès des partenaires de ce travail pour élaborer une analyse au plus près des besoins. En premier lieu, la maille géographique retenue est celle des sept grands bassins hydrographiques (les grands fleuves et leurs affluents) qui se divisent en 40 bassins versants.
Ils ont ensuite étudié la demande et les consommations de sept secteurs d’activités : l’élevage, l’irrigation, l’énergie, l’industrie, le tertiaire, le résidentiel et les voies navigables (les canaux). En rapprochant ces informations du scénario du Giec dit "RCP 8,5", le plus pessimiste qui anticipe une augmentation des températures du globe de +2,4°C pour la période 2041-2060, les auteurs ont produit des évolutions selon trois scénarios :
- le premier dit "tendanciel", "qui prolonge les tendances passées", autrement dit "business as usual" ;
- le deuxième dit "de sobriété", qui mettrait en œuvre les politiques publiques annoncées relatives au secteur de l’eau ;
- le troisième dit "de rupture", qui verrait une réduction des prélèvements en eau pour tous les usages.
Pour affiner leurs résultats, les analystes ont cependant opté pour deux "futurs" possibles : l’un plus chaud et sec, l’autre aux températures plus modérées et avec plus de précipitations. Enfin, pour coller à la réalité, un pas de temps mensuel est retenu dans les simulations, 2020 servant d’année de référence.
Il va sans dire que le rapport, dont les résultats devront être repris au fil du temps (ou de l’eau...), contient une foultitude de cas de figures en fonction des variabilités (territoires, météo, activités). Cependant, les grandes tendances ont été résumées en ouverture du rapport.
Pour ce qui concerne "la projection climatique simulant les sécheresses les plus sévères, les prélèvements annuels sont stables entre 2020 et 2050 dans le scénario tendanciel et ils diminuent dans les scénarios politiques publiques et de rupture, pour un printemps-été sec". Dans cas, "les consommations doublent dans le scénario tendanciel et augmentent de plus de 70% dans le scénario politiques publiques. Dans ce scénario, les consommations atteignent 2.200 millions de m³ en juillet, l’agriculture y contribuant à hauteur de 90%."
Avec la projection climatique simulant des sécheresses moins intenses, "les prélèvements annuels diminuent entre 2020 et 2050 dans tous les scénarios : de -10% dans le scénario tendanciel à -53% dans le scénario de rupture". Quant aux consommations, elles "sont inégalement réparties entre les territoires. Ainsi, dans les bassins versants de l’Escaut et de l’Adour, dans le scénario politiques publiques les consommations triplent du fait d’une croissance de la demande en eau d’irrigation."
Le rapport de France Stratégie conclut : "Quelle que soit la projection climatique utilisée, pour un printemps-été sec, les consommations augmentent pendant la période printanière et estivale, excepté pour un cas étudié : le scénario de rupture simulé avec la projection climatique la moins pessimiste".
La croissance des consommations est liée au changement de composition des prélèvements
Et de préciser : "La croissance des consommations est liée au changement de composition des prélèvements : les prélèvements pour l’irrigation deviennent majoritaires tandis que ceux pour l’énergie diminuent. Or l’irrigation a cette particularité de consommer la majorité de l’eau prélevée en raison de l’évapotranspiration des plantes. (...) La maîtrise de la demande en eau d’irrigation nécessitera ainsi la mobilisation de différents leviers."
Les rédacteurs en tirent deux enseignements : "D’une part, avec la part croissante de l’irrigation dans les prélèvements, les prélèvements et les consommations seront davantage concentrés sur les mois les plus chauds de l’année, quand la ressource en eau est au plus bas dans les nappes alluviales et les rivières. D’autre part, l’augmentation des consommations devrait avoir des effets sur le fonctionnement des milieux aquatiques et sur les usages en aval, car moins d’eau sera restituée aux milieux. Ceci pourrait non seulement affecter durablement les écosystèmes, mais aussi contribuer à l’intensification ou à l’émergence de conflits d’usage."
À la tribune de la conférence du 21 janvier, dans la discussion sur les usages agricoles de l’eau, Luc Servant, vice-président des Chambres d'agriculture et président de celle de Nouvelle-Aquitaine, exploitant en Charente-Maritime, a minoré les hypothèses posées par les auteurs, réfutant notamment le triplement du prélèvement pour l’irrigation : "De l’eau, il en faut, mais pas trop", expliquant que les volumes sont toujours "limités et adaptés au milieu".
Le rapport s’attache aussi à détailler les conséquences de ce nouveau contexte pour chaque activité consommatrice. Retenons le cas du résidentiel. En 2020, ce secteur a prélevé 4,5 milliards de m³ d’eau et en consomme environ 650 à 700 millions.
Dans le scénario tendanciel, à l’horizon 2030-2050, "le volume d’eau utilisé par habitant demeure stable entre 2020 et 2050. Une légère augmentation de la population est observée jusqu’en 2040. La population diminue ensuite. Les collectivités territoriales poursuivent leurs efforts en faveur de la réduction des fuites des réseaux d’adduction en eau potable. Le nombre de forages domestiques continue de croître." Les prélèvements se maintiennent à 4,5 Mds de m³ et la consommation serait de moins de 700 Mm³.
Les eaux ménagères [seraient] majoritairement réutilisées, principalement à l’échelle du bâtiment, avec des traitements mutualisés en pied d’immeuble
Dans le scénario politiques publiques, "la population augmente et des actions de sobriété et d’efficacité (changement de pratiques et d’équipements) permettent de réduire les prélèvements par habitant. Avec le soutien des Agences de l’eau, les collectivités territoriales conduisent une politique de réduction des fuites sur les réseaux d’adduction en eau potable, en particulier dans les territoires où le taux de fuite est élevé. Le nombre de forages domestiques est en hausse." Les prélèvements se réduisent à 4 Mds de m³ et la consommation serait d’environ 600 Mm³.
Quant au scénario de rupture, "les prélèvements d’eau sont drastiquement réduits par le déploiement de pratiques plus efficaces d’usage de l’eau, de réutilisations décentralisées, et de séparation des urines et des matières fécales à la source. Ainsi, les eaux ménagères sont majoritairement réutilisées, principalement à l’échelle du bâtiment, avec des traitements mutualisés en pied d’immeuble et des réutilisations pour l’arrosage ou pour des usages résidentiels (chasse d’eau, lave-linge, etc.)."
Par ailleurs, "grâce à un contrôle accru, le nombre de forages domestiques stagne. Les collectivités territoriales investissent dans la réhabilitation des réseaux d’adduction en eau potable présentant les moins bons rendements". Les prélèvements chutent à 3,5 Mds de m³ en 2030 et à environ 1,7 Md de m³ en 2050, avec une consommation de 500 à 550 Mm³.
Équipements sanitaires sobres
Le rapport met aussi l’accent sur différentes solutions pour économiser l’eau : réduire le taux de fuite des réseaux – mais les réparations sont souvent jugées trop coûteuses au regard des économies prévisibles ; inciter à réduire fortement les consommations – jusqu’à 50 l/j par habitant contre une moyenne actuelle de 120 à 130 – par l’usage d’équipements sanitaires sobres (toilettes sèches, réutilisation des eaux ménagères pour l’arrosage ou la chasse d’eau ou le lave-linge…). Le rapport mentionne aussi le développement des forages domestiques à raison de 10% par décennie.
À la tribune de la conférence, Anne Grosperrin, vice-présidente déléguée au cycle de l'eau de la métropole de Lyon, a présenté la vision de la collectivité pour l’échéance 2035.
Le cadre stratégique se fonde sur la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) de la métropole, qui vise tout à la fois à restaurer les milieux – comme la lutte contre les pollutions d’origine industrielle qui perturbent l’exploitation des captages ou le développement de la ville perméable "pour garder l’eau sur le territoire" - pour reconquérir la qualité de l’eau et gérer l’eau potable "pour un accès à tous", notamment par l’instauration d’une tarification incitative. L’un des enjeux majeurs restant, pour Anne Grosperrin, de répondre à la "pression quantitative", c’est-à-dire, de fournir un service permanent.
Lire aussi
-
Avec le réchauffement climatique, les besoins passent "d'un froid de confort à un froid sanitaire" (Fedene)
-
Les bardages rapportés végétalisés font l'objet de recommandations dédiées
-
Le premier chantier de "façade réservoir d’eau pluviale" est dans les tuyaux
-
Comment les pouvoirs publics veulent faciliter la création de réseaux de chaleur
Sélection produits
Contenus qui devraient vous plaire

- VEF Réfrigération
Ingénieur études HVAC F/H

- Bureau d'Etudes Technique