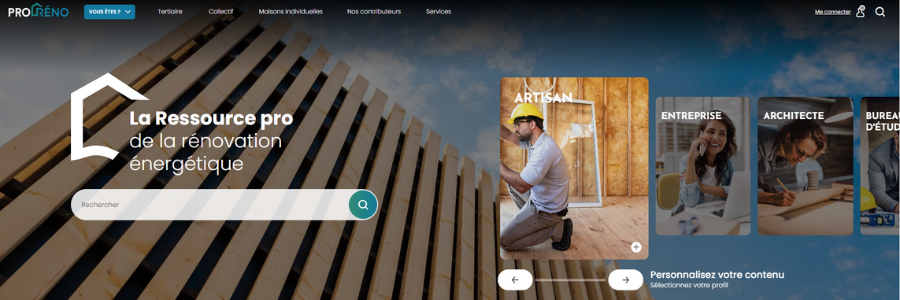"Agir en continu dans le bâtiment permet d'améliorer la qualité et d'optimiser les coûts", Dominique Bidou

Un chroniqueur chroniqué. Dominique Bidou, président d'honneur de l'Alliance HQE-GBC et auteur régulier de billets dans les colonnes d'XPair, signe "Recivilisation. Pour un futur durable" chez Kubik Éditions, un ouvrage qui invite les acteurs du bâtiment et du cadre de vie - et plus largement les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile - à rouvrir le dialogue et à s'inspirer des initiatives fleurissant çà et là pour repenser la manière de faire société… et de construire des logements et bureaux.
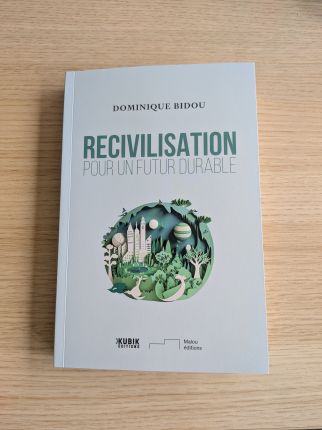
"Recivilisation. Pour un futur durable" de Dominique Bidou est paru chez Kubik Éditions. © Corentin Patrigeon pour XPair
XPair : Dans votre dernier livre, vous appelez à éviter le piège du "C'était mieux avant" tout en déplorant que le discours écologiste actuel s'embourbe dans la culpabilisation des citoyens…
Dominique Bidou : Actuellement, le discours politique dominant est un discours assez déprimant ! Ce n’est pas ainsi qu’on va faire changer la société, qu'on va vraiment entrer dans le XXIe siècle. On raisonne encore comme au XXe, comme pendant les Trente Glorieuses qui nous ont mis dans la tête qu’une croissance infinie est possible et qu'elle va permettre de résorber les déficits. La bascule économique s’est produite avec les chocs pétroliers des années 1970, qui ont cassé une dynamique. Mais le système mental, le mode de pensée n'ont pas changé et nous mènent aujourd'hui dans le mur.
Pour trouver des solutions, vous évoquez "de nombreuses initiatives" qui sont lancées un peu partout. À quoi pensez-vous précisément ?
D. B : On pourrait me reprocher de ne pas proposer de solutions, or je propose de penser différemment pour justement trouver des solutions. J’invite les consommateurs, les entreprises, les politiques, les médias à adopter d’autres canaux, d’autres références. Les solutions de demain ne viendront pas d’en haut, de quelques sachants, mais devront venir de la société elle-même. Joseph Stiglitz [économiste américain, lauréat du prix Nobel d'économie en 2001, NDLR] parle de société apprenante, qui doit intégrer toutes les nouveautés pour en tirer quelque chose de positif, car le changement est plus difficile quand on n’y est pas préparé.
"On ne dispose pas toujours du coût financier des mesures qui ne sont pas prises, mais on s'aperçoit malheureusement souvent de leur coût social !"
Des expérimentations positives et intéressantes existent, comme les "Territoires zéro chômeur de longue durée", qui partent du principe que les financements cherchant à résorber le chômage en aval devraient être mobilisés en amont pour créer des emplois. Elles démontrent que le budget de l'État n’est que la traduction d’un certain nombre de décisions politiques qui peuvent anticiper les problématiques économiques et sociales. On ne dispose pas toujours du coût financier des mesures qui ne sont pas prises, mais on s'aperçoit malheureusement souvent de leur coût social ! Et plus on accepte de ne rien faire, plus on accepte de creuser les déficits.
C'est pourquoi je suis favorable à une forme de croissance de bien-être, qui n’a rien à voir avec la croissance traditionnellement exprimée en PIB (Produit intérieur brut). On part du postulat que le bonheur est relié au PIB, que plus on produit, plus on peut consommer. Tous nos indicateurs de croissance sont liés à la production mais pas aux services rendus, c’est-à-dire à la qualité de vie des individus. Un indicateur comme le PIB est simple car il donne une vision d'ensemble et tout le monde peut s’y référer. Mais il n’intègre pas certains aspects de la qualité de vie.
Comment cela pourrait-il se traduire dans le secteur du bâtiment ?
D. B. : Des études ont démontré que la précarité énergétique dans le bâtiment a un coût social, en matière de santé et d’éducation ; un coût qui n'est pas uniquement porté par l’État mais aussi par les individus. Et ce coût est supérieur à celui de la rénovation thermique de l’ensemble du parc. Est-ce que nous ne pourrions pas réduire ce coût en amont par des actions ciblées ?
N’étant pas économiste, je lance donc un appel aux économistes pour qu'ils intègrent à leurs calculs les coûts cachés et les coûts évités. Je suis convaincu qu’un bâtiment bien conçu coûte beaucoup moins cher qu’un bâtiment mal conçu. Il coûtera probablement plus cher au départ, ce qui représentera alors, non pas un surcoût, mais un surinvestissement. Néanmoins, en réduisant sa consommation d'énergie, on sera capable de réduire le prix réel des logements qu'il proposera.
Le problème est que le système économique actuel nous empêche de procéder ainsi. Un mètre carré doit être appréhendé comme une unité fonctionnelle, plutôt que de chercher à réduire systématiquement les coûts des projets. Réaliser régulièrement des travaux de rénovation, de modernisation et d’amélioration d’un bâtiment coûte 3 à 4 fois moins cher que de le laisser se dégrader pendant une longue période. C’est en agissant en continu qu’on améliore la qualité et qu’on optimise les coûts.
"La transition électrique n’est pas qu’un simple changement de source d'énergie mais une amélioration des performances, avec des externalités positives en matière d’environnement et de santé."
Mais nous ne sommes pas actuellement organisés pour réfléchir de la sorte. Nous sommes coincés dans une toile d’araignée qui nous empêche d’expérimenter d’autres choses. C’est pourquoi le développement durable est une affaire d’entrepreneurs, c’est-à-dire des gens qui prennent des risques et qui ne font pas comme on a toujours fait, tout en évitant que les solutions d’aujourd’hui ne deviennent les problèmes de demain.
Si la protection du capital humain et du capital financier n’est pas assurée, le risque est grand que les investisseurs génèrent une fausse croissance. Les normes et les réglementations sont là pour leur dire ce qui ne doit pas être dégradé. Cela dit, si l'on compte uniquement sur la raison, sur le rationnel, on n’y arrivera pas. Il nous faut aussi de l’émotionnel.
Vous avez intitulé l'un de vos chapitres "L'électricité en vedette". En quoi l'électron se retrouve-t-il sous les projecteurs ?
D. B. : L’électrification est très importante à beaucoup d’égards : le bâtiment, le transport, l'industrie… Cette transition électrique n’est pas qu’un simple changement de source d'énergie mais une amélioration des performances, avec des externalités positives en matière d’environnement et de santé, par exemple en matière d'amélioration de la qualité de l’air. Mais là encore, nos systèmes comptables actuels nous éloignent de la prise de conscience liée à la transition énergétique en ignorant un grand nombre de facteurs et de paramètres. Si nous n’élargissons pas notre vision et ne rapprochons pas nos idées, nous ne réaliserons pas l’examen de conscience nécessaire au changement.