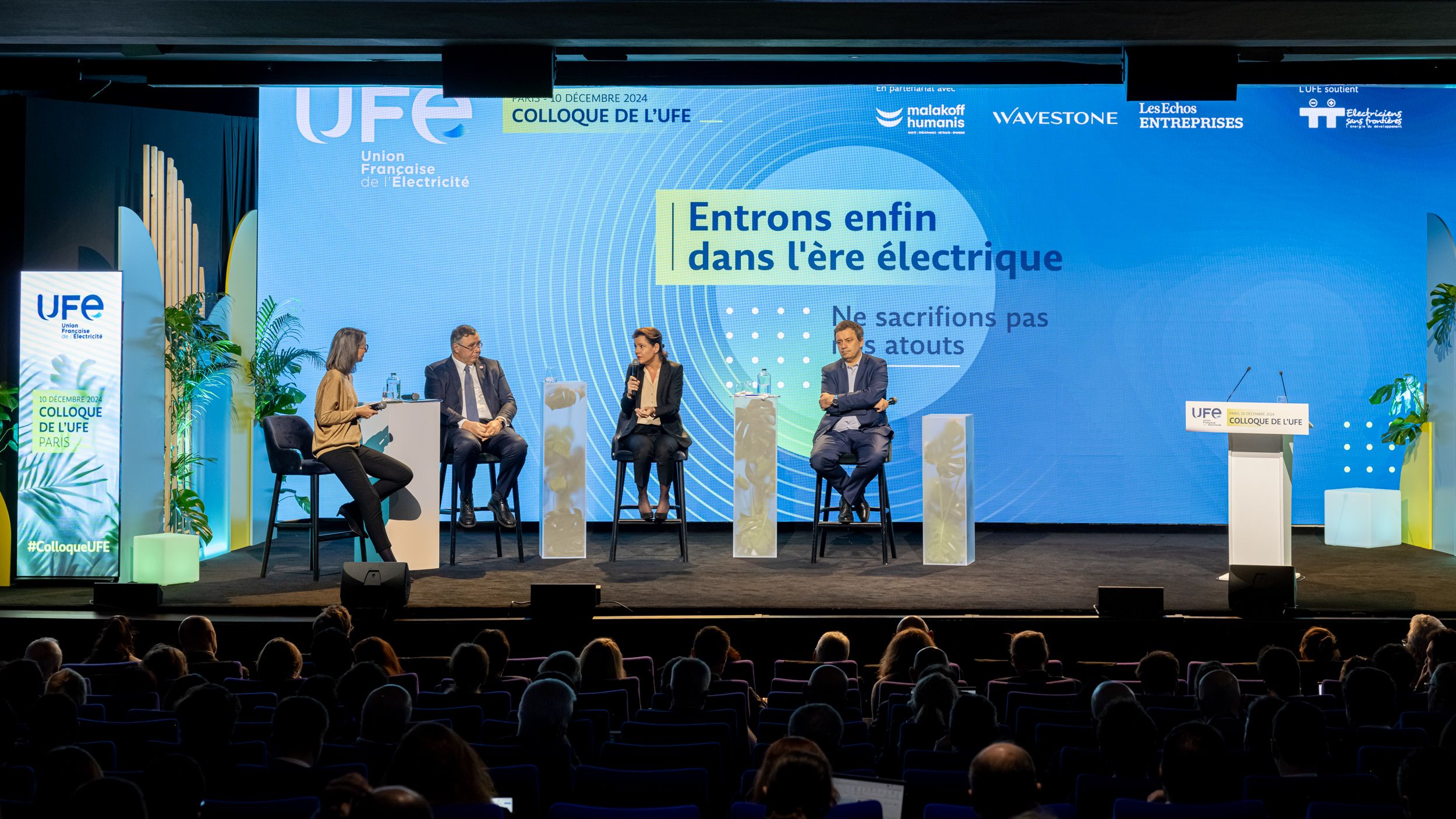"C'est une énergie quasi-inépuisable" : ce qu'il faut savoir pour tirer profit du solaire thermique

Le solaire thermique a aussi sa place en maison individuelle. Dans le cadre du projet Fare (Former les acteurs de la rénovation énergétique) et du dispositif Rex Bâtiments Performants, l'Agence Qualité Construction (AQC) a détaillé lors d'un webinaire les difficultés et points de vigilance de cette source d'énergie pour une production d'eau chaude sanitaire (ECS) comme en système solaire combiné (SSC).
La présentation est d'abord revenue sur les principes de base du fonctionnement du solaire thermique. "C'est une énergie quasi inépuisable", affirme Lionel Nicolo, expert solaire thermique à l'Ines (Institut national de l'énergie solaire). "Il convertit le rayonnement solaire en chaleur pour produire de l’ECS et/ou du chauffage, en Cesi (chauffe-eau solaire individuel) ou SSC, avec différents types de capteurs solaires thermiques."
Alors que les besoins sont importants dans le résidentiel comme dans le tertiaire, le chauffage solaire aurait pour intérêt, en direct comme en accumulation, d’être constant sur l’année. Mais la première étape d'une telle installation consiste à bien choisir son capteur.
"Chaque capteur va avoir son utilité et son efficacité. Les capteurs plans vitrés sont les plus répandus en Europe et présentent le meilleure rapport qualité/prix, avec une très bonne durée de vie (20-25 ans) et un très bon rendement (60-80 %). Les capteurs à tubes sous vides sont surtout intéressants pour leur rendement à haute température, ils se réservent plutôt aux climats froids et pour des applications spécifiques. Les capteurs non vitrés ne sont pas protégés et ont une déperdition plus importante, leur rendement est donc limité et ils sont utilisés pour des applications piscines et basse température", détaille Lionel Nicolo.
"Retour en grâce" des systèmes solaires combinés
Le marché installé totalise 2,5 millions de mètres carrés de panneaux solaires. D’après les chiffres d’Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables) arrêtés à 2023, presque 60.000 m² ont été posés en Cesi classiques et autostockeurs – ces derniers étant plutôt à réserver à des régions ne connaissant pas d'épisodes de gel.
Les spécialistes constatent en parallèle une forte progression des SSC depuis quelques années, une sorte de "retour en grâce" de ces systèmes un peu délaissés au profit des pompes à chaleur, alors que les produits sont pourtant "de plus en plus fiables et performants". Dans le détail, on raccorde environ 80.000 m² par an, répartis entre 70 % pour le logement individuel et 30 % pour le tertiaire et le résidentiel collectif.
Sur ce dernier segment, le solaire thermique entre en concurrence avec la Pac, bien que les professionnels assurent ne pas vouloir opposer les énergies renouvelables entre elles. "Il y a de la place pour tout le monde et l’essentiel est de décarboner", insiste Lionel Nicolo. En termes de ventes, les années 2018-2019 auraient été les plus fructueuses sur le segment du solaire thermique.
Baisse de la sinistralité
La sinistralité des installations, elle, est en baisse : en moyenne entre 2015 et 2023, on a recensé 0,28 sinistre pour 1.000 m² en maison individuelle, pour un coût moyen oscillant entre 2.000 et 8.000 €. Les principales causes des sinistres sont bien identifiées : les problèmes d'étanchéité et d'infiltration de la toiture arrivent largement en tête avec 55,6 %, suivis de manière plutôt étonnante par les sinistres "autres" et "non classés", avec 27,8 %. Les fuites des circuits, de glycol ou des raccords représentent 11,1 % des incidents.
"Cela a malgré tout tendance à ternir l’image du solaire thermique, avec des conséquences techniques et économiques pour l’usager : inconfort thermique, insatisfaction et réclamations, démarches administratives complexes…", liste l'ingénieur.
D'après une étude basée sur des rapports d'experts, "les sinistres des capteurs solaires concernent l'étanchéité, tandis que sur la partie chauffe-eau solaire, ils sont davantage liés au dimensionnement, à la conception et la régulation ainsi qu'aux raccordements", précise Samuel Daucé, responsable de projet à l'AQC.
Pour lui, "les sept domaines clés pour la qualité d’une installation solaire thermique sont le dimensionnement, la conception, la mise en œuvre, le circuit primaire, le circuit secondaire, la régulation et la maintenance/suivi". La filière a d'ailleurs rencontré pendant des années des problèmes de dimensionnement, souvent liés à un manque de connaissance des installateurs. "La règle pour la surface des capteurs Cesi, c'est 1 à 1,5 m² pour deux personnes occupant le logement", souligne Lionel Nicolo.
Commencer par établir les besoins en ECS
Car les impacts potentiels peuvent être nombreux : surchauffe estivale, dégradation ou vaporisation du fluide caloporteur, coûts de maintenance élevés ou encore réduction de la durée de vie de l’installation. Parmi les autres bonnes pratiques, les spécialistes préconisent un ratio optimal de 50 à 75 L/m² de capteurs pour le volume du ballon, une orientation plein Sud avec une tolérance de plus ou moins 45° ainsi qu'une inclinaison des capteurs de 40 à 50° pour le Cesi et de 50 à 60° pour le SSC.
"Il faut déjà déterminer les besoins en eau chaude des occupants. Les professionnels sont de plus en plus formés mais cette problématique peut persister", prévient Lionel Nicolo. "Pour le Cesi, il faut viser un ballon de 200 à 300 L pour 4 personnes, et pour le SSC, de 500 à 1.500 L selon la surface habitable." L'ingénieur invite à privilégier les ballons favorisant la stratification, avec eau chaude en haut et eau froide en bas. De même, un ballon bien dimensionné optimise le stockage de l’énergie solaire et évite les surchauffes estivales.
"Il faut aussi réaliser une étude des ombrages (masques solaires) avant l’installation afin de les éviter, la période critique étant les heures de fort ensoleillement, c'est-à-dire de 9 h à 15 h. Une orientation Sud de +/- 15° et une inclinaison de 45° permettent d’obtenir plus de 95 % du potentiel maximal", poursuit l'expert.
Sur les défauts d’étanchéité, il est tout simplement recommandé aux installateurs ne maîtrisant pas le sujet de faire appel à un couvreur. Dans ce domaine, les bonnes pratiques consistent notamment à respecter les DTU (40.5 et 65.12), utiliser des systèmes de fixation homologués et certifiés avec Avis Technique, installer une bavette métallique sous les capteurs et assurer un relevé d’étanchéité.
"Attention car une isolation défaillante peut gravement compromettre la performance énergétique de l’installation et entraîner des dommages irréversibles sur le circuit hydraulique", alerte Lionel Nicolo. L’isolation des canalisations impose également de prendre quelques précautions : avoir une épaisseur minimale de 19 mm pour des diamètres inférieurs à 20 mm, une résistance à plus de 150 °C minimum, une protection UV obligatoire avec une gaine aluminium ou PVC pour l’extérieur et une continuité sans pont thermique.
Lire aussi
-
La cybersécurité, l’ombre numérique au tableau de l'énergie solaire
-
La filière fait front contre le projet de hausse de TVA sur les Pac hybrides et le solaire thermique
-
En manque de perspectives, le solaire thermique sollicite l'aide des pouvoirs publics
-
Le solaire thermique individuel "définitivement pas dans la bonne dynamique"
Sélection produits
Contenus qui devraient vous plaire

- Actual Paris Bâtiment 257
Monteur en gaine de ventilation (H/F)

- VF Centre