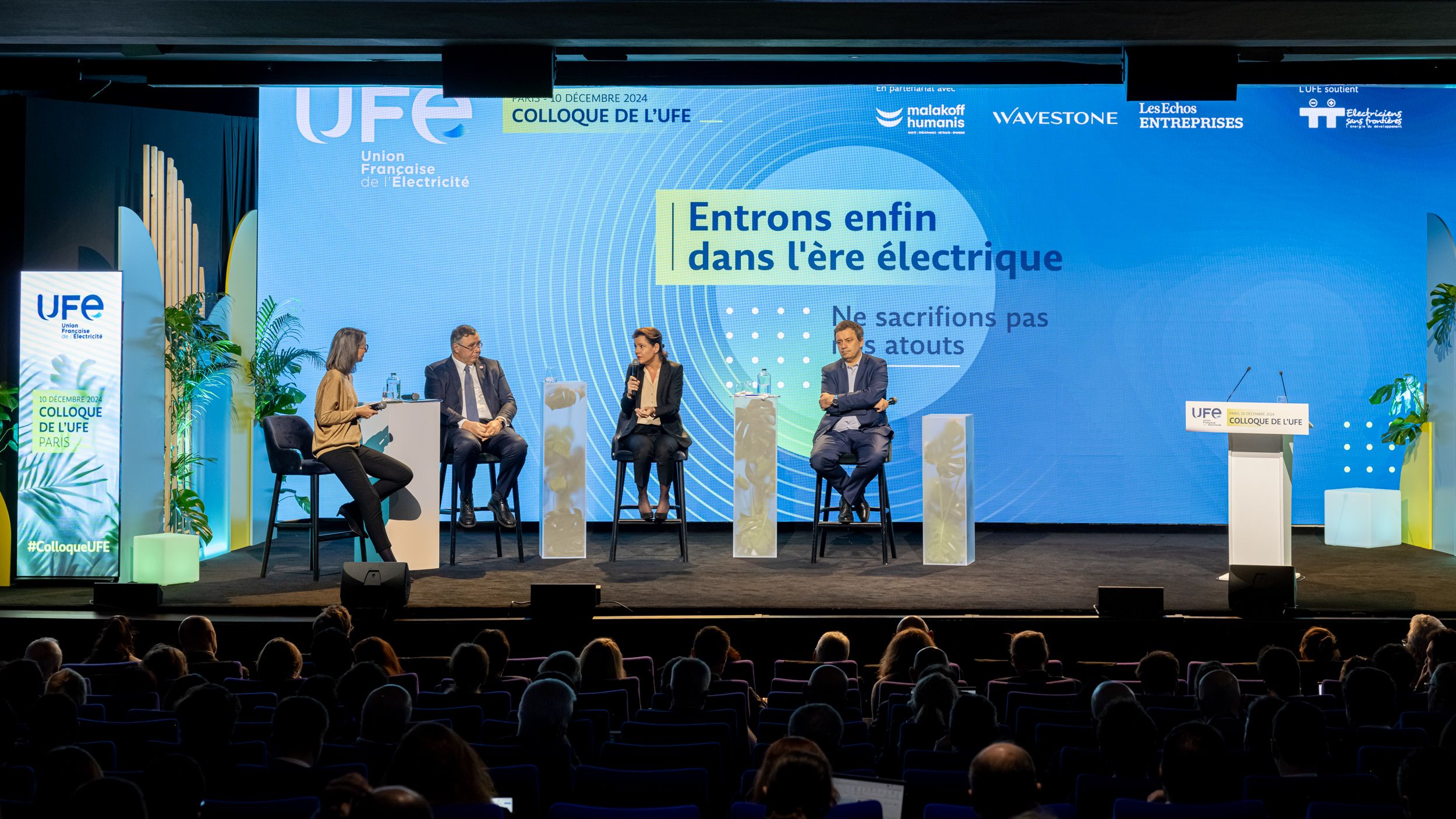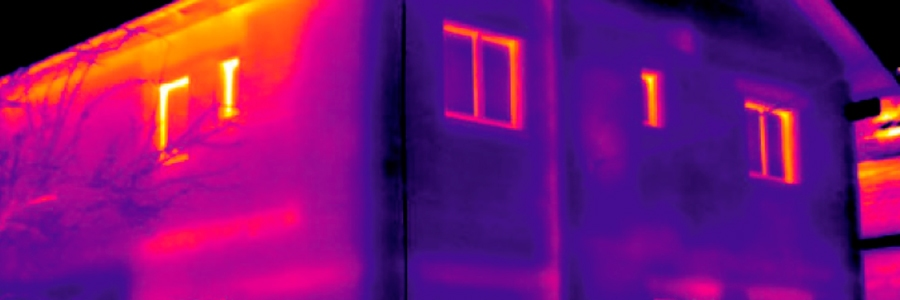Les projets solaires en milieu rural face au paradoxe de l’acceptabilité

"Quatre-vingt-quatre pour cent des Français interrogés déclarent avoir une bonne image des énergies renouvelables, solaire et hydraulique en tête, suivis de la géothermie et du biogaz, et même les riverains d’installations affichent une adhésion renforcée [94 %, NDLR], ce qui souligne les retombées économiques locales et relativise les nuisances." Ce sondage Ifop de mai 2025 a été évoqué par l'animatrice Nathalie Croisée, lors d'une table ronde intitulée "Transition énergétique, entre adhésion locale et tension électorale", organisée en octobre par le forum EnerGaïa.
Les organisateurs de l'évènement dédié aux énergies renouvelables, qui se tiendra les 10 et 11 décembre à Montpellier, ont également relayé un autre sondage du Réseau Action Climat : publié cet automne, celui-ci souligne que les Français sont très préoccupés par les enjeux environnementaux et climatiques et qu’ils sont favorables à 89 % aux panneaux solaires sur bâti existant et à 75 % au développement des ENR, éolien et solaire.
"Si on installe un gros projet éolien à côté d’une petite commune sans que cela lui rapporte, je ne suis pas convaincu qu'il soit accepté. Que cela soit bon pour le climat n’est pas suffisant. C’est là où le partage de la valeur a toute sa place", relève l'élu.
Le rôle de la concertation
L’influence des élus
"Désormais, on sait qu’il va y avoir des controverses, des résistances, des refus […]. Le permis légal d’opérer, c’est très bien, mais aujourd’hui on a aussi besoin d’un permis social d’opérer si on ne veut pas que les projets s’arrêtent à mi-chemin, qu’ils soient détournés, contournés. Quitte à prendre plus de temps qu’initialement prévu pour débattre, il est important de prendre en compte ce débat", poursuit-il.
Bien sûr, selon les connaissances des élus sur ces sujets, la probabilité d’acceptation sera plus ou moins grande. "Le lien avec les élections est direct, parce qu’on voit bien que certains maires, en préparation des municipales, se positionnent parfois défavorablement sur ces projets pour éviter d’avoir des retombées négatives. Pourtant, nous, au Cese (Conseil économique, social et environnemental), on sait faire des compromis pour que toutes les parties prenantes y trouvent leur compte", nuance Nicolas Richard, conseiller au Cese et vice-président de France Nature Environnement.
Le débat n’est pas une garantie
Lire aussi
-
Le photovoltaïque toujours dans l'attente d'une feuille de route pour se projeter en 2050
-
En manque de perspectives, le solaire thermique sollicite l'aide des pouvoirs publics
-
ENR : un guide pour saisir les enjeux du développement du photovoltaïque en France
-
France Renouvelables et France Travail s'associent pour fournir des bras à la filière ENR